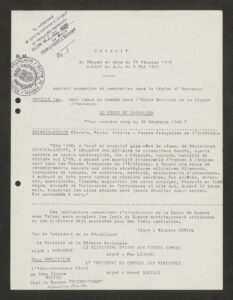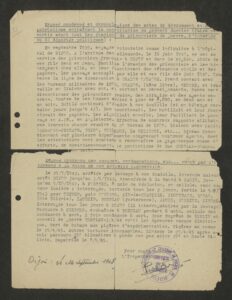Un réseau pionnier : le réseau Grenier-Godard
17 juin 1940, l’occupation de Dijon débute. Très vite, de nombreux Dijonnais initient les premières manifestations du refus de la défaite et parmi eux, une famille du quartier Saint-Michel, les Grenier-Godard : Alphonse, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, gazé sur le front d’Orient en 1917, Blanche, infirmière engagée dès septembre 1939 et leurs deux jeunes fils, René quinze ans et Jean onze ans.
Sous l’impulsion de Blanche, la cheffe de réseau, les activités clandestines se développent : évasions de prisonniers, faux papiers, passages de la ligne de démarcation, renseignements, aide aux Juifs. Le réseau compte plus de trois-cents membres en 1942.
Une femme, une famille, un quartier, un engagement précoce, une répression féroce, une mise en lumière importante mais brève avant un oubli presque complet, tels sont les éléments essentiels de ce réseau dijonnais.
En savoir plus
La forte présence des femmes et leur rôle central est une caractéristique originale du réseau Grenier-Godard. Une femme, Blanche, l’a organisé et l’a commandé jusqu’à son arrestation en juillet 1942. Elle en est aussi la liquidatrice après la Libération. Parmi les 280 dossiers complets recensés, on relève 68 dossiers de femmes soit 25 % du total. C’est un chiffre plutôt élevé quand on le compare à d’autres cohortes étudiées. Olivier Wieviorka cite les chiffres de 10 % et de 16 % pour les effectifs féminins de Franc-Tireur et de Défense de la Franc . Cette forte présence de femmes issues pour la plupart de milieux populaires dans le réseau dijonnais s’explique par les missions effectuées : aide matérielle apportée aux prisonniers évadés, aux persécutés et missions de renseignement. Il n’est pas question bien sûr de résistance armée. La citation d’Henri Rol-Tanguy, « La moitié de notre travail eût été impossible sans l’action des femmes », est pleinement vérifiée par l’étude du réseau Grenier-Godard. Il ajoutait en parlant des militantes communistes : « Sans elles, aucune organisation n’aurait pu exister durablement. On les a souvent oubliées après la Libération » . On peut avec Olivier Wieviorka observer « une entrée significative des filles de Marianne dans l’
L’histoire du réseau Grenier-Godard permet aussi d’observer l’engagement des jeunes dans la Résistance, ces « belles figures d’enfants français », pour citer l’expression utilisée par Blanche dans le mémoire de proposition rédigé pour l’obtention de la Croix de guerre pour son fils aîné René.
Aux côtés de René, qui a joué un rôle essentiel et a été à l’initiative avec Blanche du développement du réseau, on trouve son frère cadet Jean. D’autres jeunes sont aussi impliqués dans le réseau : Jean Louvier, Jean Vigneron, Bernard Romand, Marcelle et André Grenier. Selon le témoignage de Jean Grenier-Godard et Jean Louvier, ces très jeunes ont « obéi » à leurs parents. Ils faisaient « les commissions » qu’on leur avait demandées et étaient « contents de le faire ». Ils ont joué un rôle moins prestigieux que les adultes, mais néanmoins dangereux et essentiel. Jean Vigneron a en charge la caisse qui contient les documents et tampons permettant de faire les faux papiers et est chargé de la mettre à l’abri en cas de danger. Jean Louvier, Jean Grenier-Godard et Marcelle Grenier guident les prisonniers évadés. S’il est très difficile dans les années 1950 de concevoir que des jeunes adolescents aient pu résister, aujourd’hui c’est un fait reconnu et les « belles figures d’enfants français » du réseau Grenier-Godard confirment cette réalité.
Dimitri Vouzelle, enseignant détaché aux Archives départementales de la Côte d’Or
Contexte
Combattre et résister au temps de la Seconde Guerre mondiale
Les résistants de l'intérieur contre l’occupant nazi s'organisent en réseaux d'évasion et de renseignements pour les Alliés. Plus tard, ils mettent en place de la même manière des filières d'évasion à partir des frontières pour les juifs menacés de déportation. Ils diffusent des tracts et des journaux clandestins qui dénoncent les mensonges de la propagande des nazis ou du gouvernement de Vichy.
Des organisations structurées naissent en zone occupée comme les mouvements Ceux de la Résistance, Défense de la France, Libération-Nord, et dans la zone Sud, Combat, animé par Henry Frenay, Libération-Sud avec d'Astier de la Vigerie et Franc-Tireur...
En 1941, le Parti communiste entre dans la Résistance après l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie. Il apporte à la Résistance son expérience de la clandestinité, son sens de l'organisation et ses nombreux militants motivés par leurs idées politiques. Les communistes et leur organisation militaire (Franc-Tireurs Partisans) organisent des attentats contre les Allemands, notamment des officiers. En représailles, les forces d'occupation exécutent des otages. Après 1943, de nombreux jeunes qui refusent le STO, service de travail obligatoire à effectuer en Allemagne, viennent grossir les rangs de la Résistance. Les maquis se développent.
Les attentats contre les transports de troupes et de marchandises vers l'Allemagne se multiplient. C'est la bataille du rail.
La répression allemande, aidée par les collaborateurs de Vichy, est impitoyable ; les résistants sont pourchassés, torturés, exécutés ou déportés.
Complément(s)
Image(s)
Attribution du grade de chevalier de la Légion d’honneur à Blanche Godard.
Exposé condensé et chronologique des actes de dévouement et patriotisme de Blanche Godard
Site(s)
Pour tout savoir sur le réseau Grenier-Godard, c’est ici.